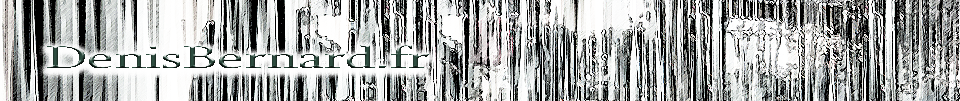Par milliers, les ouvriers des vallées... (p.36)
L’après-midi, lorsque le cortège a déroulé son interminable ruban tout au long de l’avenue qui conduit à la Préfecture, j’ai reçu en pleine face le déferlement de la réalité sociale que j’avais jusqu’alors ignorée.
Par milliers, les ouvriers des vallées sont venus jusqu’à la ville y porter leur colère. Une colère trop longtemps contenue derrière les murs des cités miséreuses. Une colère irradiée par la joie de pouvoir enfin déployer sa force et montrer son courage. Les ateliers, les bureaux, les écoles étaient là au complet. Tous, au coude à coude, exprimaient une même volonté, une même conviction. Les femmes étaient venues avec les enfants. Elles aussi criaient qu’elles voulaient vivre autrement. Chacun revendiquait des droits pour tous et tous exigeaient la liberté et le partage.
C’était ma première manifestation de rue. J’ai suivi le défilé avec application. Je me suis laissé emporter par la marée, cherchant à en grossir le flot sans pourtant m’y engloutir totalement, car je voulais trop savoir jusqu’où irait la vague. Mon attente fut déçue. Le cortège, immense, bloqué contre les grilles de la préfecture, décida de se disloquer après des discours véhéments, mais trop raisonnables pour se porter à la hauteur de l’Histoire. Comment une telle force, comment un peuple ouvrier tout entier — si puissant, si rassemblé — pouvait-il se satisfaire de paroles où tout était remis à plus tard !
Dans les rangs des lycéens, dispersés au milieu de la foule qui refluait, des appels étaient lancés, des rendez-vous étaient pris. Allan — puisque c’était bien lui — avec ses acolytes, ramenait vers la Grand-Place, où s’allumaient déjà les réverbères, quelques irréductibles. J’ai suivi cette petite troupe autant par curiosité que par désœuvrement. Un tract fut diffusé à l’issue de ce meeting improvisé. Il invitait à poursuivre la lutte. J’ai mis ce papier dans ma poche et seul – j’avais perdu dans la multitude mon compagnon du matin –, j’ai repris le chemin du lycée.